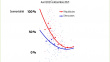Sujet de plus en plus mis en lumière, la soumission et la vulnérabilité chimiques sont pourtant vecteurs de nombreux raccourcis et fausses vérités qui ralentissent le combat contre ces agressions. Le plan national contre le GHB, lancé par le gouvernement en février 2022, est un bon exemple de la mésinformation qui entoure ce phénomène. Si la mesure est vue comme une avancée, elle semble inadaptée à la réalité des agressions. « Rappelons que les molécules les plus rencontrées dans les cas avérés de soumission chimique sont les antihistaminiques sédatifs (Donormyl, Atarax…) ainsi que les benzodiazépines et apparentés (Xanax, Lexomil…) dont les hypnotiques (Stilnox et Imovane) », liste Jean-Pierre Goullé, professeur émérite de toxicologie. « En 2019, sur 574 cas suspects enregistrés, 53 relevaient d’une soumission chimique vraisemblable dont un seul mettait en cause le GHB », précise-t-il en citant l’étude chapeautée par l’ANSM et menée par le centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance de Paris. Mis en place depuis 2003, ce recueil annuel a vocation à caractériser, sur la base de faits scientifiques, le mode opératoire des agresseurs, le contexte des méfaits et les vecteurs facilitants. « La grande majorité des données proviennent de sources judiciaires, ajoute Leïla Chaouachi, experte auprès de l’ANSM pour cette étude et pharmacienne au centre d’addictovigilance de Paris. Or, selon l’enquête de victimisation "Cadre de vie et sécurité" 2009-2017, seuls 10 % des victimes de viols ou de tentative de viol déposent plainte. »
Soumission et vulnérabilité
L’ANSM distingue la soumission chimique et la vulnérabilité chimique. Le premier cas est le fait de droguer sans son consentement une personne à des fins criminelles ou délictuelles. Dans le second, « la victime consomme d’elle-même une substance psychoactive qui la place dans un état de fragilité la rendant plus vulnérable à une agression », décrit Leïla Chaouachi. Ces définitions permettent de distinguer des actes prémédités de situation d’opportunisme. « Quelles que soient les circonstances, il est important de rappeler que la victime n’est jamais responsable de son agression », insiste-t-elle. L’étude de l’ANSM aide aussi à mettre l’accent sur les lieux des agressions. « Si la plupart des signalements suspects concernent les milieux festifs, on observe que les soumissions chimiques vraisemblables se déroulent essentiellement dans le cadre privé », nuance l’experte. Pour ce qui est de la vulnérabilité chimique, les zones de tensions se manifestent généralement en sortie de lieu festif. « Si les consommations de substances ont bien lieu dans des bars ou autres, les délits ou crimes surviennent souvent dans l’espace public ou privé », analyse-t-elle. Le mythe du rôdeur demeure très ancré et se focaliser dessus invisibilise les autres profils. « Les auteurs sont généralement connus des victimes », poursuit Leïla Chaouachi, et cette réalité ne transparaît que très peu dans les outils de réduction des risques proposés. On a ainsi vu apparaître des capuchons à verre, des vernis ou des bandelettes pour détecter quelques substances par une méthode non validée, présentés comme des barrages au crime. Mais ces éléments, principalement à destination des femmes, entraînent l’idée que les hommes ne sont pas de potentielles victimes et laissent penser que l’agresseur est nécessairement un inconnu.
Une lutte en évolution
Tout n’est pas à jeter ou à revoir. « Ces outils sont de bons supports de communication, mais il ne faut pas les prendre pour la panacée. Ils permettent d’éveiller les consciences ce qui est déjà positif », note-t-elle. Le mouvement #BalanceTonBar et les agressions à la piqûre ont aussi joué leur rôle. « Il y a eu une mobilisation de tous les acteurs, des établissements festifs aux experts, pour réduire les risques et optimiser la prise en charge des victimes », détaille Leïla Chaouachi. Désigner un membre du groupe pour veiller sur les autres, comme un « Sam » pour l’alcool, ne surtout pas s’isoler en cas de doute ou encore utiliser certaines des applications développées contre ce phénomène sont les meilleures mesures à prendre. « Quel que soit l’outil, la vigilance solidaire est la meilleure réponse à apporter », assène-t-elle. Reste alors à assurer un accompagnement des victimes après l’agression et les pharmaciens ont une place à prendre dans ce cadre. Première course contre la montre : les dangers sanitaires contre les effets de la drogue, mais aussi les infections potentielles et notamment au VIH. Les officines peuvent diriger les victimes vers des centres d’addictovigilance, Drogue Info Service ou encore le 116 006, numéro de d’aide aux victimes qui offre un conseil juridique. Encourager le dépôt de plainte est nécessaire. « La victime sera orientée vers les unités médico-judiciaires pour constater les éventuelles lésions et réaliser des prélèvements conservatoires nécessaires à l’enquête, souligne Leïla Chaouachi. Plus cette prise en charge est précoce, plus elle permettra de mettre en évidence des éléments de preuve. Pour les prélèvements à visée toxicologique, si le dépôt de plainte dépasse une semaine, il sera toujours possible de prélever les cheveux à distance des faits pour révéler les substances. » Même à très faible dose, les psychoactifs peuvent être repérés grâce aux techniques de détection de pointe. En 2010, dans une note à destination de l’Académie de médecine, Jean-Pierre Goullé et trois autres collaborateurs estimaient que le phénomène était « trop souvent méconnu par les médecins […] et à l’origine d’erreurs de diagnostic », s’expliquant par « l’absence totale d’enseignement de toxicologie au cours des études médicales ». Mais aujourd’hui, « le milieu est bien mieux informé, sensibilisé et vigilant sur ce sujet », rassure-t-il.