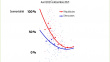C’est une étude à laquelle vous n’avez pas pu échapper mi-novembre. Selon IMS Health, le cabinet de conseil favori des laboratoires, et le Cercle de réflexion de l’industrie pharmaceutique (Crip), la Sécurité sociale pourrait économiser pas moins de 9 milliards d’euros par an en améliorant l’observance des patients traités pour maladies chroniques. Une estimation impressionnante basée sur le calcul du coût des complications liées à un non-suivi des traitements médicamenteux, ce dernier étant évalué à 60 % en moyenne sur les six pathologies ciblées (hypertension artérielle, asthme, diabète de type 2, ostéoporose, insuffisance cardiaque et hypercholestérolémie). Cette enquête avait, selon ses promoteurs, pour objectif « d’appeler à une large mobilisation des acteurs concernés » autour de l’observance, au premier rang desquels les autorités, leur suggérant notamment de déclarer ce sujet « grande cause nationale » en 2016. Cette opération de communication, plutôt réussie si l’on en juge par les larges retombées dans la presse, est loin d’être la seule sur le sujet ces derniers mois. Début 2014, la Fondation Concorde avait publié un livre blanc sur le sujet, en association avec la société spécialisée Observia. Avec une évaluation plus timorée du coût de la non-observance – 2 milliards d’euros – mais une revendication commune : donner plus de place à l’industrie pharmaceutique dans les actions qu’elle mène en matière d’observance.
Reconnaître l’innovation
Le Crip ne s’est pas contenté de réclamer une mobilisation sur le sujet mais a également demandé la mise en place de mesures incitatives sonnantes et trébuchantes pour les médecins, avec une intégration dans la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp) d’un bonus proportionnel au taux d’observance des patients. Mais aussi la mise en place de dispositifs similaires pour les pharmaciens, en plus des missions confiées dans le cadre des entretiens pharmaceutiques. « On voit qu’il y a des discussions importantes sur la rémunération des pharmaciens, une observance faible, qui est un problème de santé publique mais aussi une source d’économies massives et où tout le monde ne peut être que d’accord », explique Denis Delval, président du Crip. « Il y a probablement des mécanismes d’incitation à mettre en place », ajoute-t-il, sans souhaiter donner plus de précisions sur ce qu’ils pourraient être dans la pratique. « Ce n’est pas à nous de décider », précise-t-il, pour ne pas risquer de froisser l’administration. Au-delà de l’enjeu proclamé de santé publique, les laboratoires ont évidemment des intérêts à défendre. D’une part, cela leur permet de relancer une bataille qu’ils mènent depuis des années, sans succès. Celle de la reconnaissance par les pouvoirs publics des innovations dites « incrémentales ». Denis Delval, reprenant un discours devenu un classique de la communication des laboratoires, regrette ainsi, à la faveur de la publication de cette étude, que les améliorations apportées par les fabricants sur la galénique ne soient pas assez prises en compte par les autorités lors de l’évaluation des médicaments.
« L’observance
pour vendre
des médicaments ?
C’est n’avoir rien
compris aux enjeux
que d’affirmer cela. »
« Le prix du médicament est essentiellement défini sur la base du niveau d’amélioration de service médical rendu (ASMR) défini par la commission de la transparence, commente-t-il. L’innovation incrémentale est un sujet sur lequel il est toujours difficile de faire reconnaître nos efforts, pour lequel nous avons déjà alerté les autorités et qui reste d’actualité. » Éric Baseilhac, directeur des affaires économiques du Leem (Les Entreprises du médicament), révèle un autre enjeu de l’observance pour les industriels. « Là où ce facteur entre en compte, c’est dans la négociation [avec le Comité économique des produits de santé, CEPS] d’accords de prix de type partage de risques ou de prix conditionnels », explique-t-il. Dans ces accords (voir « Hépatite C à prix d’or », Le Pharmacien de France, n° 1264), le laboratoire obtient du CEPS un prix temporaire initial, susceptible d’être révisé en fonction de l’efficacité du traitement en « vie réelle ».
Plus de liberté pour Big pharma
Pour les fabricants, la maîtrise de l’observance devient alors stratégique, puisqu’elle peut influer sur la renégociation des prix. D’où leur intérêt à obtenir un rôle plus important en la matière. « Il y a un paradoxe, quand nous sommes de plus en plus responsabilisés sur la valeur de nos médicaments en vie réelle, à ne pas être autorisés à agir sur elle », fait valoir Éric Baseilhac, estimant que, depuis les réformes qui ont découlé de la loi Mediator, il y a un « cordon sanitaire autour de l’éducation thérapeutique qui nous empêche d’aller plus loin et de construire des projets efficaces ». L’industrie a en effet pour interdiction d’intervenir dans la conception ou la rédaction des programmes. Elle ne peut que les financer. Éric Baseilhac rejette en outre catégoriquement les accusations selon lesquelles les laboratoires s’intéresseraient uniquement à la question pour vendre plus de médicaments. « Ce n’est pas le sujet et c’est n’avoir rien compris aux enjeux que d’affirmer cela. Notre objectif est uniquement de permettre au médicament d’être efficace, car c’est sur cette efficacité que nous serons jugés. Il faut démystifier les craintes que l’on a pu avoir sur ce sujet, car nous serions tous – patients, payeurs, industriels – gagnants à améliorer l’observance », affirme-t-il.
À l’assaut des officines
Malgré l’interdiction de communiquer directement avec les patients – les industriels se défendent d’ailleurs de vouloir le faire – les laboratoires multiplient les initiatives pour asseoir leur présence dans l’observance. Tout d’abord en finançant des programmes d’apprentissage à destination des médecins, officinaux et jusqu’aux infirmiers, qui doivent néanmoins systématiquement être étudiés par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). Ils font également feu de tout bois pour entrer dans l’officine par la porte de l’observance. En offrant, comme le font Teva et Sandoz, des outils informatiques d’aide à la conduite d’entretiens pharmaceutiques.
40 % C’est l’observance
moyenne des patients,
selon l’étude
IMS Health/Crip.
En réalisant aussi des études pour mesurer l’efficacité de l’information délivrée par le pharmacien, comme le fera à partir de mars Pfizer, en association avec la FSPF et la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD), prenant pour cible les patients souffrant de douleurs neuropathiques. Avec à la clé une rémunération pour les officinaux qui y prendront part. Un projet qui impliquera une centaine d’officines et dont le but est de mettre en évidence la plus-value du pharmacien dans la délivrance de messages d’observance. Eu égard au nombre relativement restreint de patients qu’elle devrait inclure – entre 200 et 250 –, on peut s’interroger sur la portée scientifique de cette étude, qui ressemble plus à une campagne de communication. Le fabricant a d’ailleurs prévu de diffuser ses résultats dans la presse médicale et pharmaceutique, ainsi que lors d’un congrès. « Les laboratoires sont de plus en plus intéressés par ce type d’étude », constate-t-on à la FSPF.
Autre tactique, l’arrivée en France de sociétés travaillant pour le compte des laboratoires, comme Patient Connect. Cette dernière propose une rémunération aux pharmaciens qui acceptent d’utiliser un logiciel contenant des messages liés à l’observance quand un médicament précis est délivré. Une offre pouvant sembler séduisante mais qui n’a pas été accueillie très favorablement par la FSPF qui estimait que ce système posait problème, notamment du point de vue déontologique. Mais à l’heure actuelle, rien n’empêche un officinal de s’inscrire sur le site de Patient Connect pour souscrire à ses services… Les industriels semblent ainsi bien décidés à jouer l’ensemble des cartes qu’ils ont en main pour occuper le terrain de l’observance, sans oublier celle des formations qu’ils dispensent déjà en officine sur ce thème.
Le « SAV » du médicament
Cet intérêt des laboratoires pour l’observance n’est pas nouveau. Déjà, en 2008, Prescrire publiait les conclusions d’un rapport de l’Inspection générale des affaires sanitaires (Igas) qui démontait une tentative de l’industrie pour obtenir l’autorisation de programmes d’aide à l’observance destinés aux patients. Une tentative à laquelle Roselyne Bachelot, ministre de la Santé à l’époque, avait tout d’abord prêté une oreille attentive, mais qui avait finalement échoué. Ce qui n’a pas empêché les fabricants de revenir plusieurs fois à la charge par la suite, notamment lors de la définition de la réglementation sur l’éducation thérapeutique, via un texte les autorisant à concevoir ces programmes d’aide à l’observance. Mais lorsque l’Igas fut saisie en 2007 pour donner son avis sur ce projet, alors présenté par le ministre suivant, Xavier Bertrand, le constat fut sévère. Et l’idée dut être retirée peu après, devant la contestation de la quasi-totalité du monde de la santé en raison de l’accès direct aux patients qui aurait ainsi été donné aux laboratoires.
« En somme,
les programmes
d’aide à l’observance
ont une efficacité
très limitée. »
L’Igas avait notamment considéré que ces programmes s’apparentaient à du « service après-vente », ayant pour finalité de « fidéliser » les patients à une marque. Elle avait en outre pointé qu’elle souhaitait les voir réservés aux produits avec une ASMR de niveau I ou II, et sans alternative thérapeutique. Avec comme principe de base l’interdiction de tout contact direct entre patients et industriels, ce qui reste la norme à ce jour. En 2007, Prescrire avait publié un autre article sur la question, en reprenant notamment les résultats de plusieurs méta-analyses mettant en question leur efficacité. « En somme, les programmes d’aide à l’observance ont une efficacité très limitée », écrivait la revue. Et au-delà de leur efficacité médicale, leur intérêt économique n’est pas évident. Interrogé par Le Pharmacien de France, Claude Le Pen, économiste de la santé et consultant d’IMS Health, a reconnu que la démonstration était très compliquée à réaliser, et qu’en tout état de cause une telle étude n’existait pas en France à sa connaissance. Mais là n’est peut-être pas le réel enjeu : avec l’observance, les laboratoires trouvent un prétexte idéal pour se positionner dans l’antichambre du patient, aux limites de la loi. Avec, une fois n’est pas coutume, le pharmacien d’officine comme intermédiaire incontournable.