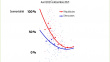Philippe Even épinglé pour ses liens avec l’industrie pharmaceutique après avoir pourfendu les conflits d’intérêts, ça vous inspire quoi ?
Je ne connais pas le fond de cette affaire mais, qu’il s‘agisse de Philippe Even ou d’autres, l’idée n’est pas de traquer des personnes mais de réveiller des consciences. Quelles influences ces conflits d’intérêts peuvent-ils avoir sur nos pratiques professionnelles ou nos décisions de soins, ou même sur l’enseignement ? N’y a-t-il pas certaines situations auxquelles il faut mettre un terme ?
Votre seul conflit d’intérêts déclaré est avec une start-up suisse, dont vous êtes membre du comité de surveillance et de suivi. Est-ce par choix ?
Cela fait une douzaine d’années que j’ai coupé les ponts avec l’industrie pharmaceutique. Moi aussi je suis « allé à la soupe », donc je sais qu’il n’y a pas d’un côté les bons et de l’autre les méchants, mais j’ai assez tardivement compris que ma pratique professionnelle pouvait se passer de ces liens très puissants et aussi très séduisants. Quand l’industrie pharmaceutique vous nomme à un board, vous envoie à un congrès ou vous propose d’être orateur avec des diapositives déjà prêtes, tout cela est flatteur et rémunérateur… Ma prise de conscience remonte à bien avant l’affaire du Mediator, un médicament qu’en tant que pharmacien hospitalier je n’ai jamais acheté mais que je n’ai pas dénoncé non plus. Ayant fait partie d’un conseil scientifique réputé indépendant mais en réalité lié à un industriel, je me suis interrogé sur la raison qui poussait cet industriel à prôner une posologie 25 % supérieure à celle qui me paraissait la mieux adaptée. À partir de ce moment-là, j’ai considéré qu’il était raisonnable d’arrêter. Et, deux ans après avoir été sollicité pour devenir juré du prix Galien [ce prix, créé il y a quarante-cinq ans, vise à récompenser les innovations thérapeutiques, NDLR], j’ai également quitté cette position pour les mêmes raisons.
Pourtant, impossible de se passer des industriels… Alors, que préconisez-vous ?
L’industrie pharmaceutique est constituée d’entreprises dont l’objectif consiste à fabriquer des médicaments grâce à des capitaux privés et qui a vocation à faire du profit. C’est logique, nous sommes dans une économie libérale qui leur a confié ce rôle. Qu’il y ait des dérives dans l’industrie est une chose, mais que des institutions ou des hauts fonctionnaires deviennent complices d’un déni de vérité scientifique, cette collusion globale me choque. J’ai vu un jour le président-directeur général d’un grand laboratoire pharmaceutique français apostropher le ministre de la Santé d’un geste familier du doigt, geste que je n’oserais même pas faire à l’égard de l’un de mes internes.
Vous êtes le seul pharmacien signataire du « manifeste des 30 », qui invite à rompre tout lien avec Servier. Pensez-vous que la profession est suffisamment impliquée dans ce combat pour la transparence ?
Il se trouve que j’ai probablement autant d’amis dans le monde médical que dans le monde pharmaceutique, c’en est probablement l’explication. Mais je ne suis pas une exception culturelle.
« Les dépenses de
Lucentis représentent
10 000 postes
d’infirmiers. »
Je me suis associé à la démarche d’Irène Frachon car nous avons tous fait le serment, à l’aube de notre exercice professionnel, de défendre les patients. Or l’attitude arrogante de Servier est inacceptable. En 2010, quand l’affaire Mediator a éclaté, j’étais président de l’Académie nationale de pharmacie ; j’ai attendu la publication du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) le 15 janvier 2011 pour demander la suspension de Jacques Servier de sa qualité de membre associé de l’Académie. On m’a ri au nez. Nombre de ses collaborateurs ou proches en étaient également membres. Je me souviens en particulier de l’un d’eux qui se vantait d’avoir trois bureaux : un à l’Agence du médicament (ANSM), un à la faculté… et un chez Servier. Et ce, alors même que le Leem (Les Entreprises du médicament) avait courageusement exclu les laboratoires Servier dès le 17 janvier.Autre « affaire » dans laquelle vous vous êtes impliqué : le cas Lucentis/Avastin. Encore une conséquence de l’influence des industriels, selon vous ?
Quand une telle intrication d’intérêts existe entre les sociétés savantes – d’ophtalmologie, en l’occurrence – et les associations de patients où tout est financé par les industriels, il faut se rendre à l’évidence : les décisions ne peuvent plus être indépendantes et les connivences se mettent en place. Il suffit d’aller consulter les sites de ces institutions pour s’en rendre compte.
Que s’est-il passé en 2012 quand la direction générale de la santé (DGS) a interdit de pratiquer des injections intravitréennes d’Avastin ?
Elle seule peut le dire, mais l’industrie a évidemment fait pression. Et ce, alors qu’au même moment, le ministère de la Santé finançait une étude clinique du nom de GEFAL qui a démontré l’équivalence d’Avastin et Lucentis. Des données supplémentaires ont été apportées par les études CATT, publiée dans le New England Journal of Medicine – qui n’est tout de même pas une petite publication régionale –, ou IVAN. Si ce ne sont pas là des preuves, à quoi les essais cliniques servent-ils ? J’ai posé la question à la ministre, elle ne m’a jamais répondu. Après l’interdiction de 2012, je suis allé voir le directeur général de l’ANSM qui m’a dit : « Je n’ai été prévenu ni par le cabinet de la ministre ni par la DGS. » Quand de telles décisions sont prises, on se dit qu’elles devraient favoriser la sécurité des patients ou une meilleure utilisation des deniers publics. Pas cette fois.
La recommandation temporaire d’utilisation (RTU) permettant la délivrance d’Avastin dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) va-t-elle arranger les choses ?
Oui, mais partiellement car elle ne concerne pas les prescriptions effectuées en ville. En 2013, le Lucentis a été le premier médicament remboursé par l’Assurance maladie : 438 millions d’euros. Cela représente 10 000 emplois d’infirmiers ! Quand, autrefois, Servier réussissait à obtenir des prix deux fois supérieurs à la moyenne, il se défendait par un chantage à l’emploi. On l’a cru pendant trente ans mais concernant Avastin/Lucentis, je pose la question : les pouvoirs publics français sont-ils mandatés pour favoriser les actionnaires de Novartis et Roche ? Les consciences doivent se réveiller.
Dans le même ordre d’idée, dans le livre La Vérité sur vos médicaments, vous regrettez que le paracétamol ne soit pas substituable. Vous prônez même une baisse drastique des prix des génériques…

Il est incompréhensible que cette molécule présente dans toutes les armoires à pharmacie de France ne soit pas inscrite au Répertoire. La molécule la plus facilement substituable est celle qui l’est le moins ! Quel dommage que les pouvoirs publics n’appliquent pas les règles qu’ils édictent eux-mêmes. Le paracétamol – matière première – coûte environ 2 euros le kilo à Shanghai et environ 2 euros la plaquette de 8 grammes : une multiplication par 125 non justifiée par des efforts de recherche ! Les économies ne peuvent pas provenir de la mise sur le marché de « boîtes familiales », le paracétamol étant très hépatotoxique au-delà de 8 grammes par prise. Le prix des génériques est beaucoup moins élevé aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, il faut aller au bout de la politique du générique en maintenant une marge convenable pour le pharmacien. L’objectif doit être le même sur les biosimilaires. Le ministère de la Santé avance actuellement des prix 20 à 30 % moins élevés que leur référent ; il faut aller à moins 50 % !
Un autre de vos combats est la réhabilitation de la vaccination. Trouvez-vous dommage que les pharmaciens n’aient pas été autorisés à vacciner ?
On y viendra, le pharmacien va connaître un rôle croissant dans l’organisation et la promotion de la santé et dans l’éducation thérapeutique. La vaccination par le pharmacien en est un élément incontournable. C’est déjà une réalité dans des pays comparables au nôtre, comme le Canada, les États-Unis ou le Portugal. On vit dans une société de contradictions, avec des groupes de pression qui s’érigent contre la vaccination alors que, entre autres exemples, la diphtérie qui tuait des dizaines de milliers d’enfants en France jusque dans les années 1920 a aujourd’hui disparu dans notre pays. Cependant, il ne faut pas baisser la garde car elle est récemment réapparue en Espagne et persiste en Europe de l’Est. Si les enfants sont bien vaccinés en France, c’est moins le cas des adolescents et des adultes. Alors que des ligues dénoncent la vaccination, paradoxalement on espère la découverte de nouveaux vaccins, comme ceux contre le sida, Ebola ou l’hépatite C. Même les craintes autour de l’aluminium ne devraient pas être de nature à remettre en cause la vaccination. Son intérêt est tel que la question ne se pose pas.