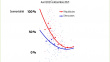La médecine personnalisée est-elle devenue une réalité ? Fin juillet, les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) de Kymriah (Novartis) et de Yescarta (Gilead) dans deux cancers hématologiques ont en tout cas ouvert la voie aux CAR-T cells. Ces médicaments d’un tout nouveau genre, issus des cellules du patient modifiées génétiquement, sauvent la vie de malades en échec thérapeutique après plusieurs lignes de traitement… mais leur arrivée dans les services hospitaliers implique une totale réorganisation des hôpitaux, afin notamment de gérer leurs effets secondaires très lourds. « C’est une vraie révolution. […] Il s’agit d’un traitement de rupture, on entre dans une nouvelle ère pour les lymphomes agressifs », s’enthousiasme la Pr Catherine Thieblemont, cheffe du service d’hématologie-oncologie de l’hôpital Saint-Louis (Paris). « Environ 80 % des patients, dont certains en soins palliatifs, sont en rémission après l’injection. Aucun traitement n’atteint aujourd’hui ce niveau », confirme le Pr Nicolas Boissel, hématologue à l’hôpital Saint-Louis et coauteur d’une grande étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 2018 pour évaluer les CAR-T Cells chez de jeunes patients âgés de 3 à 25 ans atteints de leucémie aiguë lymphoblastique résistante aux traitements. Les résultats exceptionnels ont conduit aux ATU de cohorte, un raccourci vers la mise sur le marché.
Course contre la montre
Cette nouvelle classe de médicaments ne ressemble à aucune autre, puisqu’elle a comme produit actif les cellules du malade ; elle ne peut donc pas être produite en lots. Des lymphocytes T sont manipulés génétiquement pour y introduire des gènes codants des récepteurs membranaires, les fameux CAR, pour chimeric antigen receptor. Ceux-ci sont capables de reconnaître des antigènes tumoraux présents uniquement à la surface des cellules cancéreuses.

Axicabtagene ciloleucel Autorisé depuis juillet dernier en France, Yescarta est indiqué dans certains lymphomes réfractaires ou en cas de rechute. © GILEAD
En se fixant sur leurs cellules cibles, les lymphocytes T, devenus des CAR-T cells, jouent alors leur rôle et détruisent les cellules malades. Fabriquées aux États-Unis, les CAR-T cells ont un délai d’obtention de un à trois mois. Très, voire trop long pour des malades en échec thérapeutique et dont l’état peut s’aggraver durant cette période. Un délai dû au transfert des cellules, à leur modification, à leur culture et à leur réacheminement. Ce délai pourrait être raccourci à l’horizon 2019-2020 quand Novartis et Gilead disposeront de sites de production en Europe. Cette immunothérapie d’un nouveau genre n’est disponible que dans trois hôpitaux français, deux à Paris et un à Lyon, dûment labellisés par les industriels. « Le caractère individualisé et innovant de Kymriah implique que les centres suivent une formation et nécessite de mettre en place une organisation spécifique à l’hôpital pour atteindre les standards de qualité attendus », explique-t-on chez Novartis.
Un défi économique
De fait, outre l’expertise des services, les CAR-T cells obligent à repenser le parcours patient, notamment à cause de la toxicité du traitement. « La moitié des patients injectés, déjà très fragiles et souvent en aplasie, passe en réanimation à cause d’une complication appelée syndrome de relargage des cytokines. Ce n’est pas de l’ordre de l’accident. Il nous a donc fallu intégrer le service de réanimation dans le parcours patient », explique Nicolas Boissel. Un réanimateur est ainsi impliqué dès l’évaluation initiale du patient. Quatre semaines après l’injection, la phase de complications aiguës, également liées à la toxicité neurologique, est passée, même si un risque d’infection persiste pendant quelques semaines à plusieurs mois. Outre ces effets secondaires, le poids économique des CAR-T cells est sans précédent. On se souvient de la levée de boucliers lors de l’arrivée sur le marché de Sovaldi et consorts, thérapies curatives de l’hépatite C, dont le coût avoisinait les 40 000 euros la cure. Pour les CAR-T, il faut ajouter un zéro. Ces coûts, qui dépassent aujourd’hui les 300 000 euros l’injection, risquent d’être un casse-tête pour les autorités sanitaires. « Quand je clique pour valider la commande de Kymriah, j’ai toujours un temps d’arrêt. Pour chaque injection, j’engage 320 000 euros, c’est beaucoup beaucoup d’argent », confiait début octobre Isabelle Madelaine-Chambrin, cheffe de service de pharmacie hospitalière à l’hôpital Saint-Louis.