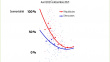Placer le patient au cœur du système de santé ? Il y a ceux qui en parlent et ceux qui l’ont fait. Comme cette poignée de convaincus qui s’est mis en tête de former et de diplômer les malades chroniques pour en faire des « patients-experts », un statut qui reconnaît leur expérience de la maladie comme une expérience, disons-le, professionnelle. Trois universités d’un nouveau genre ont ainsi vu le jour, à Paris, Marseille puis Grenoble : depuis 2009, ces « universités des patients » ont accueilli sur leurs bancs près de 150 adultes souffrant, pêle-mêle, d’un diabète, d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (Mici), d’un cancer, du VIH, d’une pathologie neurologique ou rénale, voire de plusieurs maladies à la fois. Triés sur le volet, ils sont aujourd’hui titulaires d’un certificat ou d’un diplôme universitaire (DU), certains même d’un master en éducation thérapeutique du patient (ETP). Et, à leur tour, enseignent, forment, animent ou dispensent leur connaissance de la maladie, auprès d’autres patients ou de professionnels de santé, au sein d’associations ou d’établissements hospitaliers, désormais acteurs à part entière du système de soins. Une petite révolution est en marche.
Revenants
« Au début, j’en ai pris plein la gueule ! Mais
je savais que le savoir, c’était le pouvoir. »
« Au départ, j’en ai pris plein la gueule !, se souvient avec un sourire Catherine Tourette-Turgis, la première à avoir mis le pied dans la porte des communautés universitaires et médicales, deux milieux extrêmement cloisonnés. Mais il fallait bien commencer. Je savais que le savoir, c’est le pouvoir. Et qu’il ne fallait pas barrer l’accès au savoir des malades. » C’était en 2009. « L’idée de créer l’université des patients (UDP) m’est venue quand je vivais à San Francisco dans les années 1990, raconte cette chercheuse et professeure des universités. Lors de l’arrivée des trithérapies, nous avons été confrontés à deux problèmes : l’observance thérapeutique et le retour à la santé. Je travaillais sur des programmes d’accompagnement et j’ai découvert le désir des malades de reprendre des études, de disposer d’un espace de reconstruction de soi. La mairie de San Francisco a tout de suite négocié, avec l’université de Californie où j’enseignais alors, l’inclusion de malades du sida à titre gracieux. J’en ai vu les bienfaits immédiats en termes de confiance en soi, d’estime de soi et de professionnalisation. » Car la maladie chronique brise des corps et, avec, des parcours de vie. Malade depuis l’âge de 7 ans, Corinne Devos n’a su qu’elle était atteinte d’une Mici qu’à l’âge de 36 ans.

Le Pr Catherine Tourette-Turgis, celle par qui l’université des patients est arrivée. © Géraldine Bachmann, UPMC
Des années d’errances diagnostique et thérapeutique qui lui valurent de mettre un terme à sa carrière : « J’étais responsable juridique dans un grand groupe mais il n’a pas été possible d’adapter mon poste aux contraintes qu’imposaient mes traitements, mes hospitalisations ou même la maladie. » Aujourd’hui âgée de 52 ans, son état de santé ne lui permet pas de travailler. Christelle Grossaud, elle, n’a même pas pu décrocher le baccalauréat : « Une maladie de Crohn m’a été diagnostiquée cette année-là. » Quant à Maud Amolini, elle souffre de troubles alimentaires depuis l’âge de 11 ans. Jusqu’au lycée, elle a su composer : « À partir de 18 ans, mon état de santé s’est dégradé, raconte-t-elle. Et les études universitaires ne sont pas tout à fait adaptées lorsqu’on est hospitalisée six mois sur onze ou qu’il faut rester debout quatre heures d’affilée pendant les travaux pratiques, témoigne-t-elle. Poursuivre mes études s’est donc rapidement révélé impossible. » Et c’est « avec un tuyau dans le nez, sous nutrition entérale », que la jeune femme est entrée à l’UDP de Paris, à 27 ans. Ces étudiants pas comme les autres arrivent souvent cabossés, sans diplômes, voire dans une grande précarité, mais avec un savoir précieux entre les mains et, surtout, l’envie de le diffuser. Une motivation passée au crible lors de leur candidature et discutée au cours d’un entretien : « C’est le principal aspect de la sélection, explique Laurent Bensoussan, praticien hospitalier, professeur des universités et responsable pédagogique du certificat universitaire (CU) dispensé par l’UDP de Marseille. Nous évaluons déjà l’implication vis-à-vis de la maladie, puis la motivation à suivre l’enseignement et l’envie de transmission. »
De l’expérience à l’enseignement
Une fois admis, souvent après avoir été aiguillés par l’association au sein de laquelle ils s’investissaient, ces patients intègrent un programme de 40 à 120 heures d’enseignement par an selon le cursus choisi, jusqu’à 600 heures dans le cadre d’un master, stage inclus. Ceux qui n’ont pas le bac se voient proposer une validation des acquis de l’expérience (VAE) pour intégrer la formation. Christelle Grossaud est passée par cette voie, avant d’obtenir son DU d’ETP à l’UDP de Paris, en 2010. Elle quitte alors son poste de salariée au sein de l’association François Aupetit, où elle avait déjà découvert ce que c’était que de « produire de l’information », pour occuper un poste d’assistante pédagogique à l’UDP : « Je voulais mettre à disposition mes compétences pour d’autres pathologies que la mienne. » Elle finit par intégrer le master 1 puis le master 2, tout en créant son entreprise de formation en ETP. En 2013, la maladie la rattrape à nouveau : « Au sortir de l’hôpital, j’ai voulu retrouver la sécurité de l’emploi, se souvient-elle. Je suis tombée par hasard sur une offre du centre hospitalo-universitaire d’Angers, qui cherchait un cadre de santé titulaire d’un master 2 en ETP. J’ai postulé au culot ! Et j’ai été retenue, même avec un profil de patiente-experte. »
10 % seulement des patients
devenus patients-experts
trouveront un emploi rémunéré.
Christelle Grossaud est ainsi depuis plus de deux ans ingénieure en ETP, travaille quotidiennement avec un praticien hospitalier au sein de l’unité transversale d’ETP, forme des professionnels de santé, aide à la création de programmes d’ETP, y fait participer d’autres patients-experts et… prépare un doctorat. « J’ai atteint un niveau bac + 5 et je me dirige vers un bac + 8. Le tout, sans le bac ! », se réjouit-elle. Une histoire comme en rêve plus d’un malade chronique, mais seuls « 10 % des patients qui bénéficient d’une allocation aux adultes handicapés ont trouvé un emploi ou une source de revenus », indique Catherine Tourette-Turgis. Certes, avant la formation, certains travaillaient déjà dans des associations et y travaillent toujours, forts de leurs nouvelles compétences ; d’autres touchent une pension d’invalidité et ne peuvent donc pas reprendre une vie active, mais faire de l’expérience de sa maladie une source de revenus ne va pas encore de soi. Un problème ? Pas forcément.
Professionnalisation à deux vitesses
Marie-Laure Lumediluna, présidente de l’Association des diabétiques d’Aix-Pays de Provence, qui a suivi le cursus très poussé que propose la Fédération française des diabétiques depuis 2008 et qui enseigne dans le cadre du CU dispensé par l’UDP de Marseille, le fait bénévolement. Ses fonctions relèvent d’un engagement : « Ma seule préoccupation est d’essaimer », explique-t-elle. Maud Amolini aussi occupe aujourd’hui une permanence bénévole à l’UDP de Grenoble, en plus d’être partie prenante du comité pédagogique. Reconnaissante, elle souligne que son attestation universitaire lui « a également permis de [se] resocialiser ». Même écho chez Sylvie Bouchard, littéralement « passionnée » par ses nouvelles fonctions. Cette femme aux ressources hors du commun a passé vingt ans alitée, le corps emprisonné dans un corset, après une chute à vélo. Elle n’avait que 25 ans. Et les multiples opérations chirurgicales qui suivirent pour soigner sa hernie discale, loin de la délivrer, la plongèrent dans cet enfer qu’est la douleur. Libérée de son corset à 45 ans, elle entreprend, seule, sa rééducation à raison de cinq heures par jour pendant cinq mois dans une piscine d’eau chaude, devant des hydrojets, malgré les souffrances, sachant qu’il lui fallait se remuscler. Elle récupère des capacités fonctionnelles, se met à nager, et son médecin, impressionné, lui propose de devenir patiente-experte.

Journée de cours à l’université des patients de Paris, dont 91 patients sont à ce jour sortis diplômés. © Géraldine Bachmann, UPMC
Elle décroche le DU de l’UDP de Paris en e-learning. Aujourd’hui, à 48 ans tout juste, en plus de reconduire et de nager 3 kilomètres par jour, elle anime un atelier de balnéothérapie adapté aux lombalgies chroniques au centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, à Lyon, en hôpital de jour, ainsi qu’un groupe de parole pour les patients en hospitalisation complète, coanime un atelier d’activité physique, prendra en charge deux autres ateliers à partir du mois de janvier et prépare un atelier de tricycle couché. Seule titulaire du DU ETP dans l’équipe qu’elle a intégrée, elle exerce pourtant bénévolement au titre de la Croix-Rouge française. Et, totalement dévouée à ses patients, ne se pose pas la question de sa rémunération.
Corinne Devos, titulaire du même DU, cumule ses fonctions au sein de l’association François-Aupetit avec l’élaboration, l’animation et l’évaluation de programmes d’ETP dans les services de gastro-entérologie des hôpitaux parisiens Saint-Louis et Saint-Antoine, en attendant, prochainement, ceux du Kremlin-Bicêtre et de Clamart, en banlieue. Elle enseigne par ailleurs dans les facultés de médecine de Saint-Antoine et de La Pitié-Salpêtrière, en binôme avec des professionnels de santé, auprès des étudiants de quatrième année sur l’annonce diagnostique et la relation patients-soignants. « Tout est bénévole, précise-t-elle. Je connais peu de patients-experts rémunérés pour leurs interventions. Pourtant, il est normal d’aller vers une reconnaissance et une professionnalisation de ces patients, lesquelles passent par une formation et un diplôme, mais aussi par une rémunération. » Un diplôme justement incontournable : « Lors d’une interview, en 2009, je me souviens avoir expliqué la création de l’UDP par le fait que sans diplôme en France, on ne peut rien faire, dit Catherine Tourette-Turgis. Je crois que l’idée est encore prégnante : pour être professionnalisé, seul le diplôme compte. »
La réponse
Reste deux écueils : l’accueil parfois mitigé que réservent les professionnels de santé aux patients-experts ainsi que les questions que soulève le fait de faire de sa maladie un métier. Objections rapidement balayées par la fondatrice de l’UDP de Paris : « De nombreuses activités professionnalisent les expériences de vie, avec la validation des acquis de l’expérience, par exemple. Si quelqu’un veut faire de sa vie, de son expérience, un métier, cela doit devenir possible. De toute façon, cela se fait déjà : combien de médecins, d’infirmiers, de psychologues sont devenus ce qu’ils sont parce qu’ils ont été affectés tout petits par une expérience qui les a marqués ? La résilience est un moteur pour la majorité des métiers de l’humain, poursuit-elle, alors pourquoi les malades seraient-ils exclus de cette dynamique ? » D’autant que, de façon pragmatique, l’intérêt de l’expérience du patient, structurée par le biais d’une formation solide, ne fait aucun doute pour le milieu soignant comme pour les institutions.
« Ma seule
préoccupation
est d’essaimer. »
« Les malades sont encore considérés comme une charge, un problème à traiter, alors qu’ils font partie de la réponse à l’amélioration du système de santé », assène Catherine Tourette-Turgis, qui espère voir se multiplier les UDP aux quatre coins de la France. Pour Christophe Pison, chef de la clinique universitaire de pneumologie au centre hospitalo-universitaire de Grenoble et membre du comité de coordination de l’UDP locale, « on est condamné au succès ! Il y aura des hauts et des bas, mais c’est plié. La démocratie sanitaire n’est pas une mode ».